L’association des anciens du Lycée-Collège Fromentin
Notre association a pour but premier d’unir par des relations amicales les anciens élèves ou professeurs du Lycée-Collège Fromentin de La Rochelle, mais pas seulement…
Nous contacter
Adhésion
Élèves, enseignants, membres du personnel d’hier et d’aujourd’hui, vous pouvez soutenir notre action :
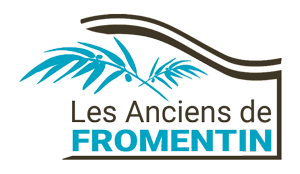

 Roland Bourguet
Roland Bourguet Association des Anciens de Fromentin
Association des Anciens de Fromentin Association des anciens élèves de Fromentin
Association des anciens élèves de Fromentin